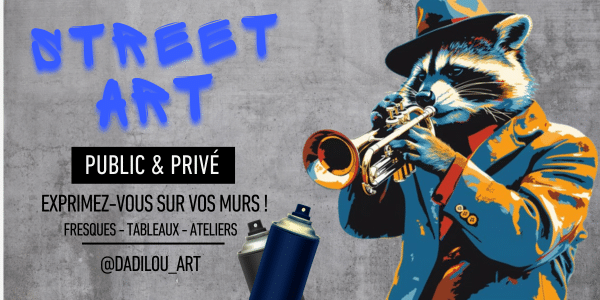Des chats, du cinéma et des patates en forme de cœur. L’exposition Viva Varda ! C’est en ce moment et jusqu’au 28 janvier à la Cinémathèque française et c’est tout de suite dans C’est comme la confiture.
Concept de Marion Labbé-Denis
Écriture et Voix de Marion Labbé-Denis
Musique Originale de Lucas Beunèche
Montage & Mixage de Lucas Beunèche
Conseil artistique : Caroline Garnier
Production artistique : Elodie Bedjai
Agnès Varda, je l’ai toujours admirée. Je sais pas, j’admirais cette femme sans avoir la liste des pourquoi bien au clair dans ma tête. Je crois que, jusqu’à très récemment, je n’avais jamais vu aucun de ses films en entier. Pourtant, je me souviens d’avoir été marquée à plusieurs reprises par des bouts de son travail, par certaines de ses interventions à la télévision, à la radio et par des archives de l’INA sur les réseaux sociaux. Alors, quand j’ai vu les affiches colorées qui annonçaient l’expo Viva Varda ! à la cinémathèque, je me suis dit que c’était le moment.
J’y suis donc allée un samedi matin d’automne
Sur le papier, c’est chic. On voit de suite les feuilles oranges qui jonchent les trottoirs, les bottines rembourrées, les petites écharpes moell’ moell’ et le bonnet à pompons. Seulement, la vraie vie c’est pas Instagram. T’as beau croiser un chien mignon et envisager de chopper un Caramel Macchiato sur le chemin, il n’en reste pas moins qu’on est samedi matin, qu’il pleut et que la seule chose orange dans le paysage c’est toi, parce que t’as eu la main lourde sur le fond de teint en pensant que ça te donnerait meilleure mine.
Par ailleurs, il est bien évident que quand tu n’en cherche pas, des cafés de la mondialisation, il y en a tous les 100 mètres, mais quand tu en cherches désespérément un pour apaiser ta douleur, tu n’en trouves nul part. J’ai quand même insisté malgré ma mauvaise humeur parce que ça m’arrive pas souvent d’aller me chercher une pinte de café chimique aromatisé à 10 balles, mais là, là j’en ressentais le besoin. Éveillée comme je l’étais, lorsque le barista m’a dit d’un air interrogatif : Un prénom ? J’ai répondu : “Oui, ce sera tout, merci.”
Oui, moi je suis toujours au taquet sur les interactions sociales, c’est une question de principe.
Donc, la réalité de cette journée, en substance, c’est que t’as les yeux qui collent, les deux pieds humides d’avoir marché dans des flaques et un cafard qui déborde du café avec lequel tu viens tout juste de brûler. Bref, c’est typiquement le genre de journée où t’écoute William Sheller avec un air triste. Voilà, c’est avec ce mood bien frais que j’ai pris le chemin de la Cinémathèque. Heureusement, au milieu de toute cette mélasse m’est apparue l’affiche de l’expo, une photo détourée d’Agnès Varda dans les années 60, en noir et blanc sur un fond fleuri et coloré, comme un phare dans la nuit.
Et en effet, en entrant dans la cinémathèque, j’ai retrouvé le sourire
La première photo que l’on voit avant même d’entrer dans l’espace d’exposition à proprement parler, c’est Agnès Varda qui fait une grimace. D’ailleurs, je me suis demandée comment elle s’appelait cette grimace, vous savez celle où l’on met son pouce sur le nez. Si, si, faites-le, vous allez voir. Vous voyez ? Et bien je me suis renseignée, j’ai tapé sur Google “Grimage, pouce sur le nez”. Et ça s’appelle un pied de nez. Voilà, maintenant, vous savez. Peut-être que vous saviez déjà ? Pas moi. Je connaissais l’expression mais j’ignorais que c’est comme ça qu’on appelait la grimace. Il paraît même qu’on peut faire un double pied de nez, en reliant le deuxième pouce au petit doigt de la première main. Oui, c’est technique. Bon, de toute façon quand on fait ça moi je trouve qu’on dirait plutôt qu’on joue de la flûte. Mais c’est une autre histoire.
Cette exposition, dès le départ, est comme : enveloppante
Dans la première salle, les images se mélangent et les sons extraits des vidéos se répondent. Il y en a un peu partout, les murs sont colorés et rien n’est tout à fait fermé, il y a des ouvertures qui permettent d’apercevoir la suite, on nous murmure visuellement que tout est lié, que ces éléments, qui ont rempli sa vie et nourri son travail ne se sont pas chassés les uns après les autres, mais se sont ajoutés, répondus, complétés, comme des feuilles de papier calque.
C’est comme un patchwork de ce que l’on découvrira ensuite
L’expo s’ouvre sur un grand portrait d’Agnès Varda avec son chat, photographiés par Jurgen Teller, dans la cour de sa maison rue Daguerre. C’est une photo vive, colorée et douce. La photo, pas Agnès. D’ailleurs en regardant ce portrait on entend aussi sa voix extraite de l’un de ses films projeté juste à côté, un extrait dans lequel elle dit d’une voix assurée : “Il faudrait nous prêter de l’argent sans intérêt pour qu’on puisse finir ce film un peu confortablement, s’il vous plait”.
À mon sens, ça plante le décors de voilà, c’est elle, la plus petite des grandes dames du cinéma
Et, comme elle le dit dans son documentaire autobiographique Les plages d’Agnès “joue le rôle d’une petite vieille rondouillarde et bavarde qui raconte sa vie”. C’est une très belle manière d’introduire à la fois, son travail, son humour et sa personnalité. Et cette première salle est à l’image de l’exposition toute entière, c’est un délicat mélange visuel et sonore, au sein duquel on entend sa voix et on aperçoit son image se mêler et se refléter dans celles qu’elle a fait des autres.
L’exposition explore le travail d’Agnès Varda par thématique, de son rapport au pictural à son engagement politique et social
Mais moi, ici, je ne sais pas tellement par quel bout prendre tout ça, alors peut-être que je vais tenter maladroitement de dérouler le fil de sa vie au début pour vous donner un peu de contexte, sans être exhaustive parce que bon, contrairement à la cinémathèque, je n’ai pas 600m2, mais une vingtaine de minutes et que peut-être qu’à un moment donné, je vais m’emballer et perdre le fil. Parce que je préfère être transparente avec vous, avec Agnès je suis partie dans tous les sens. Alors, accrochez-vous.
Agnès Varda, ce n’est pas vraiment son prénom
Son prénom avant Agnès, jusqu’à ses 18 ans du moins, c’est Arlette. Elle est née en Belgique dans une famille aisée, elle est la troisième enfant d’une fratrie de 5. La petite des grands et la grande des petits comme elle dit. Pour fuir la seconde guerre mondiale, ses parents traversent la France et s’installent à Sète, dans le sud. C’est là qu’elle grandit, sur un bateau avec ses frères et sœurs. C’est là aussi qu’elle se lie d’amitié avec la famille Schlegel, plus étroitement avec les trois soeurs Schlegel, Suzanne, Andrée, mais aussi et surtout Valentine la plus jeune, une sculptrice avec qui elle aura une relation amoureuse dont elle ne se cachera jamais sans pour autant en faire un sujet.
À 19 ans, elle fait une fugue de trois mois et travaille comme matelot sur un bateau en Corse
À la fin des années 40, elle monte à Paris et c’est là qu’Arlette devient Agnès. Elle suit des cours à l’École du Louvre le jour et à l’école de Vaugirard section photographie le soir. Dit d’elle même qu’elle était assez rebelle, qu’elle allait vite avec tout, qu’elle suivait des études, mais ne voulait pas passer d’examen parce qu’elle considérait que c’était une humiliation.
Elle dit “Je cherchais un artisanat qui soit pas trop difficile parce que j’étais maladroite.” Je me reconnais beaucoup dans cette phrase. Sauf qu’à priori, j’ai encore trouvé le mien, d’artisanat. Sauf si on considère que gribouiller des cahiers au bic et surligner des passages avec des fluos couleur pastel, c’est une forme d’artisanat, mais je crois que c’est pas encore homologué par la Fédé. Bref, Agnès Varda est donc devenue photographe.
En 1951, elle s’installe avec Valentine rue Daguerre, dans le 14ème arrondissement de Paris
C’est amusant, parce qu’à l’époque elle est photographe, et Daguerre, c’était un précurseur de l’histoire de la photographie. Elle installe un labo photo dans cet atelier dans lequel elles vivent toutes les deux. Et c’est de cette période que date la photographie que j’aime tant qui s’appelle Corps en forme de noix. Cette photo, elle me fait penser à Edward Weston qui, dans les années 30 a réalisé toute une série de photographies de poivrons en noir et blanc. Des poivrons qui ressemblent à des corps, justement.
Elle a aussi été photographe officielle du festival d’Avignon, créé par Jean Vilar en 1947, puis du Théâtre National Populaire jusqu’en 61
Je ne connaissais pas du tout son travail de photographe, mais l’exposition m’a permis de le découvrir. Elle a photographié, tout autant des anonymes que des personnalités connues, autant ses voisins que des gens qui vivaient à l’autre bout du monde. Elle a voyagé en Chine, à Cuba, au Portugal, en Allemagne.
Vers 24 ans, elle a eu envie de faire un film, “comme on fait un poème qu’on laisserait dans un tiroir”
C’est pas moi qui le dit, c’est elle. Mais à ce moment là, elle hérite de deux millions de francs de son père, alors le film ne restera pas dans le tiroir. Même si elle n’a vu que 7 films de toute sa vie et qu’elle n’y connait pas grand chose, elle décide de tout investir dans une société de production, enfin une coopérative. En 1954, elle crée Ciné-Tamaris pour pouvoir produire son premier long-métrage, La pointe courte. Ça raconte la fin d’une histoire d’amour mise en parallèle avec celle des habitants d’un village de pêcheurs.
C’est marrant parce qu’elle a réalisé ce film cinq ans avant La Nouvelle Vague
Et on a beaucoup dit que c’était un film précurseur de ce mouvement, d’ailleurs elle se présente elle-même, plus tard comme la grand-mère de la Nouvelle Vague. Bon, moi je suis un peu sceptique, déjà avec cinq ans d’écart je suis pas sûre qu’on puisse être la grand-mère de quelqu’un. Et puis, je me dis. En fait, Agnès Varda, c’est la Nouvelle Vague. Je veux dire, c’est la première. Pas la première femme, juste la première, tout court. Peut-être qu’elle a simplement démarré la Nouvelle vague avant Godard, Truffaut et leurs petits potes.
On dit que la Nouvelle Vague utilise les nouveaux moyens techniques, filme la rue, fait appel à des acteurs pas pros et laisse une belle place à l’improvisation
On dit qu’ils explorent de nouvelles manières d’écrire avec l’image et le son. Oui, oui. C’est justement ce qu’on retrouve dans La pointe courte en 1954. Pourtant on s’accorde à faire démarrer le mouvement “à la fin des années 50”. C’est marrant, non ?
En 1962, Agnès Varda signe Cléo de 5 à 7, qui assoie son talent et sa singularité dans le milieu du cinéma
C’est l’histoire d’une femme qui attend les résultats d’analyse d’un examen de santé alors qu’une cartomancienne lui a prédit le pire. La définition de l’enfer de n’importe quel hypocondriaque. Dans ce film, elle explore les limites du temps objectif et du temps subjectif. C’est à la fois un film de fiction et quelque part un film documentaire comme presque toute l’œuvre d’Agnès Varda en fait.
Plus tard, Madonna a voulu faire un remake de ce film, mais elle a pris peur quand Agnès Varda a commencé à évoquer tout ce qu’il fallait faire et la liberté dont elle avait besoin pour travailler sur ce projet. Ça ne cadrait pas vraiment avec le système de production des studios hollywoodiens, alors le projet est tombé à l’eau. Au cours de l’expo on les voit en discuter sur un plateau télé et on voit que Madonna regrette un peu d’avoir laissé tomber.
Je crois que c’est aussi pour ça que j’ai aimé cette exposition, on y voit aussi beaucoup de projets qui n’ont pas aboutis
Ce qui donne plus de relief, de contraste au travail d’Agnès Varda. Ce que je veux dire, c’est qu’on ne cherche pas à raconter une histoire, avec un début, un milieu et une fin. On ne suit pas un fil chronologique de ses réalisations sans tenir compte de ce qui a été abandonné entre-temps. On ne cherche pas à créer du sens à tout prix, comme si tout était prédestiné, on ne cherche pas à rationaliser, à mettre de l’ordre dans son parcours, à ajouter des parce que et des pourquoi.
Et j’aime bien ça, moi. Parce que cette façon de raconter les histoires, en créant des rapports de causes à effets dans tous les sens, elle nous pousse à en chercher constamment du sens même quand l’histoire est en train de se vivre, elle tend à en effacer la complexité. Alors que la vie en train de se vivre c’est le bordel, et que du sens on ne peut en trouver qu’une fois qu’on est plus dedans. Et même là, même après, il n’a rien de définitif ce sens, c’est une question de point de vue. Et c’est vraiment pas cette histoire qu’a raconté Agnès tout au long de sa vie. Au contraire, elle parle de hasards. Elle dit même que le hasard est son meilleur premier assistant.
Agnès Varda elle dit aussi :
J’ai toujours aimé les puzzles. Il manque des pièces. Comme s’il fallait accepter qu’on a pas toutes les pièces du puzzle, le savoir est partiel, l’amour aussi. On ne peut pas avoir toutes les pièces.
Alors, cette expo elle fonctionne un peu comme ça, il y a un truc avec ces salles ouvertes, ces sons qui se superposent, c’est comme un labyrinthe. On se perd dans son œuvre. Puis on croise et on décroise. On suit des liens, et puis on passe à d’autres. Sans jamais tout à fait percer le mystère, peut-être parce qu’il n’y en a pas forcément non plus.
J’ai aussi découvert des films documentaires qu’elle a réalisé, notamment celui qui s’appelle Du côté de la côte
J’ai beaucoup ri. C’est tellement drôle le décalage entre les images et les commentaires qui sont faits en voix off très sérieux, du type “Le camping est la forme la plus aérée de la liberté. Surpeuplé de bons vivants.” ou encore en parlant des habitants de la côte d’azur “Notre propos n’est pas de photographier les indigènes, qui, selon l’imagerie conventionnelle, sont toujours vieux et toujours charmants.” Avec ces documentaires, elle renouvelle un peu le genre.
Agnès Varda, elle a quelque chose de l’ordre de la fantaisie, de la poésie et ça, depuis toujours on dirait
Elle est très drôle, elle va loin dans ses délires. Et moi, ça, j’adore. J’ai passé mon BAFA avec un instructeur qui disait “Il faut toujours aller jusqu’au bout de la blague”. Et je crois qu’Agnès, elle faisait un peu ça.
Dans Les plages d’Agnès, un film de 2008 où elle retrace un peu sa vie, elle dit “Je crée aujourd’hui des images qui m’ont habitées depuis longtemps”
Elle installe une baleine sur la plage, pose des miroirs dans les vagues, recrée une plage en plein milieu de la rue Daguerre. Elle raconte comment elle devait manoeuvrer en quatorze fois pour garer sa voiture dans la petite cour de sa maison, et elle se met en scène en train de le faire, dans une voiture en carton, ça me tue. Cette inventivité, cet humour, elle nous embarque dans son univers avec un tel naturel, Les plages d’Agnès, vraiment, c’est du Boris Vian en fait. Et puis même, le concept de ce film, quelqu’un voulait faire un film sur elle et elle a dit “Euh non en fait, c’est moi qui vais le faire”.
En 1957, Agnès Varda est en couple avec Antoine Boursellier, un acteur, qui deviendra plus tard metteur en scène et directeur de théâtre et d’opéra
Enceinte de sa fille Rosalie, elle décide que leur vie de couple ne lui convient pas, et déclare sa fille à la mairie comme étant “de père inconnu”. Elle élève seule Rosalie pendant plusieurs années, mais pas en mode quelle tristesse. Non, c’était plutôt un choix. Et l’image qu’on pouvait avoir d’une mère célibataire dans les années 60, elle s’en fichait éperdument à priori. Rosalie Varda, sa fille, qu’elle appellera bien plus tard son gouvernement, et qui est d’ailleurs la directrice artistique de l’expo, elle dit que c’est là que l’on voit à quel point elle pouvait être dure, parce qu’elle a pris sa décision et point.
Mais moi, je crois que le film L’une chante, l’autre pas, qu’Agnès Varda a réalisé en 77, ça m’a donné une autre lecture de tout ça
Bon, déjà j’ai a-do-ré ce film. Et je sais, je sais, que c’est compliqué de s’emballer pour un film des années 70. Je veux dire, quand tu connais pas particulièrement le film, ni l’univers de la réalisatrice, t’es un peu en mode, ah ouais ça a l’air incr’, mais dans les faits, jamais de la vie un dimanche soir tu t’imposes un truc pareil. T’es plus facilement attiré par L’amour est dans le pré ou par une énième rediffusion d’Astérix et Obélix mission Cléopâtre. Un truc qui se laisse regarder sans trop être concentré. Un truc pas trop intello, où tu te laisses porter par l’histoire.
Et c’est là, c’est là qu’Agnès Varda est trop forte. Parce que même 45 ans après leur sortie, ses films ils se regardent sans effort, on appuie sur Play, et ça déroule, et on est dedans et on y reste jusqu’à la fin. Ce qui ne les empêche pas d’être hyper riches mais tu n’as pas à fournir un effort que de concentration pour les apprécier. Ils sont accessibles. Je ne sais pas comment vous dire, faut aller voir.
Bref, nous disions L’une chante, l’autre pas, est sorti en 77
J’ai été frappée par la liberté qui s’en dégage, qui n’oublie pas la peine et les drames, mais qui ne les raconte pas en faisant reposer tout le malheur du monde sur les femmes et de leurs choix, ou sur les conséquences de ceux qui les déçoivent. Quelque part on est habitués à voir la liberté des hommes s’exercer et souvent quand c’est représenté au cinéma on est pas tant surpris. Ce que je veux dire, c’est qu’on est plus enclins à dire “Oh là là là, il s’est barré, ah pas cool, ça va pas être facile, pour les enfants et tout, la guigne.” mais si une femme décide de partir, sans être physiquement ou psychologiquement détruite ou menacée, simplement parce qu’elle est exerce sa liberté, qu’elle souhaite partir, et qu’elle part, on trouve que c’est encore plus un monstre d’égoïsme.
Chez Varda c’est différent
Elle ne diabolise pas une seule seconde la liberté des femmes, que l’on présente partout ailleurs par le biais des conséquences. Dans L’une chante, l’autre pas, Pomme qui vit avec son mari en Iran souhaite accoucher de son premier enfant en France. Mais, elle lui dit aussi qu’elle ne reviendra pas en Iran. Lui, il dit “Oui, oui, c’est ça, on en reparle après”. Pomme accouche de leur premier enfant et après l’accouchement, elle n’a pas changé d’avis. Le film ne la blâme pas pour ça. Son mari lui dit tu peux pas faire ça, tu peux pas rester en France avec mon fils, si tu veux rester tu restes, mais moi je repars avec l’enfant. Elle dit d’accord.
Elle accepte qu’il décide et qu’il retourne vivre en Iran avec leur fils en sachant qu’elle ne le reverra probablement pas
Et instinctivement, il y a une petite voix qui dit quoiii, mais comment, mais c’est horrible, comment elle peut faire ça. Mais, dans les faits, c’est aussi sa décision à lui d’imposer ça. Je sais bien que la gymnastique est complexe. Mais on a tellement l’habitude de voir les mères tout sacrifier pour leur enfant, que ça choque beaucoup plus dans ce sens là et que dans des tas d’autres films, on aurait diabolisé sa décision à elle. Là, la décision est simplement prise. Et la situation qui en découle n’est pas plus du ressort de son mari que du sien.
Ce que je veux dire, c’est qu’au regard du film, on réalise que ces décisions là peuvent se lire différemment
On sort un peu de l’image de la mère sacrificielle. Bien sûr que c’est complexe et que ça a des conséquences, mais il n’est pas admis d’office que c’est à elle de les porter, ces conséquences. C’est un autre angle, un autre angle qui renverse beaucoup de choses, et que trouve très intéressant.
Au tout début du film, le père de Pomme lui dit : “Pour les filles qui ne font pas d’étude, il n’y a que Le mariage ou la prostitution”
Et elle répond du tac au tac : “Oh C’est un peu pareil, hein”. plus tard, il lui dit : “On verra si tu fais mieux quand tu en auras des enfants”, et elle répond “Oh bah, j’ai d’autres projets figure toi”. Et en voyant ce film, je me suis dit, mais il y a tellement de discours qui datent de cette période et qui sont encore d’actualité. C’est un film qui montre et parle d’IVG et du planning familial, un film qui reprend en chanson : “L’homme est le bourgeois, et la femme, le prolétariat.” un film dans lequel on entend une ado de quinze ans dire à son mec “Je veux être sûre que je veux”, un film dans lequel on voit déjà d’autres façons de faire famille, d’autres façons de vivre la parentalité. Enfin tout ça quoi, un vrai bol d’air.
Agnès Varda, semble avoir été une femme libre mais pas dans la crainte ou dans l’attente d’en payer le prix
Elle donne l’impression d’avoir pris soin de sa liberté comme s’il s’agissait d’une nécessité pour vivre, pour avancer, pour créer. Pour autant, même si on dit que la liberté a pour prix la solitude, je n’ai pas l’impression qu’elle ait été seule. Elle a construit sa vie comme un espace changeant. Comme quelque chose qui ne serait pas figé ou voué à un but en particulier, et peut-être que c’est ça aussi sa force. Elle a aimé, elle a essayé, ses histoires d’amour ont jalonné sa vie sans jamais la définir.
A gardé des liens avec ceux avec qui elle a partagé ces histoires, ce qui veut dire que l’on peut, peut-être, vivre la fin d’une histoire sans se séparer des gens qu’on a aimés. Elle a parfois raté, ou abandonné, mais elle est restée fidèle à elle-même tout au long de sa vie, quitte parfois, à ce que ses films ne marchent pas. Quitte à ce qu’elle n’ait pas “Sa carte du parti”, comme elle dit et qu’elle soit contrainte à aller chercher les financements de ses films seule, en parallèle de leur réalisation, parce que ses exigences ne cadraient pas avec le milieu du cinéma ou avec les attentes du public.
Au début des années 60, elle rencontre Jacques Demy au festival de court-métrage de Tours
Ils y présentent tous les deux un de leur film, et là, c’est une grande histoire. Ils vivaient ensemble rue Daguerre, se rendaient parfois visite sur les tournages mais travaillaient chacun de leur côté. C’est amusant parce qu’ils faisaient tous les deux le même métier, mais ne parlaient pas de leurs films ensemble. En même temps, il faut dire qu’ils avaient des univers très très différents. Quand on voit les films enchantés de Jacques Demy et le travail d’Agnès Varda, il y a un monde entre les deux.
Je suis tombée sur une interview d’Agnès Varda dans un documentaire de Pierre-Henri Gibert
Elle parle d’un désaccord qu’ils ont eu au sujet du film La Mélodie du Bonheur, une comédie musicale américaine. Elle dit “Non mais la boniche de 14 enfants qui se fait épouser pour pouvoir continuer à travailler gratuitement, je ne pouvais pas croire qu’il aimait ce film, j’ai cru qu’on allait se taper dessus”. Et j’aime tellement ce franc-parler, cette façon d’être cash pistache dans ses interviews. Elle s’exprimait extrêmement bien mais ne tournait jamais autour du pot.
C’est peut-être pour cette raison aussi qu’elle avait la réputation d’avoir un caractère bien trempé. En 1963, Les parapluies de Cherbourg, de Jacques Demy remporte la Palme d’or à Cannes. C’est la consécration pour lui. Et là, c’est direction Hollywood, pour tout le monde. Enfin Agnès choisit de l’accompagner pendant un temps. En parallèle de ce que vit Demy avec le succès de ses films, Agnès, elle, s’intéresse aux mouvements de la société américaine, aux Hippies, au Black Panthers.
Son fils, Mathieu Demy, naît en 1972
Elle réalise le film Daguerréotype. Un portrait des commerçants de la rue Daguerre. Elle tourne ce film à moins de 50 mètres de chez elle, parce qu’elle ne voulait pas trop s’éloigner de son fils. Elle fait régulièrement tourner ses enfants dans ses films. D’ailleurs Mathieu Demy est devenu acteur, scénariste et metteur en scène et Rosalie Varda costumière et directrice artistique pour le cinéma. Après sa rupture avec Jacques Demy, Agnès Varda réalise Documenteur. Un film au sujet d’une rupture au cours duquel elle raconte la sienne.
Mathieu Demy joue dedans et la monteuse du film Sabine Mamou joue le rôle d’Agnès. Il y a dans ce film, des répliques bouleversantes. Les proches demandent, “Mais qu’est-ce qui s’est passé ?” Et la principale concernée répond, “Je ne sais pas”. Lorsqu’elle emménage avec son fils dans un nouvel appartement, il lui demande, “Et si je ne suis pas content, qu’est-ce qu’on va faire ?” Et la voix off de l’actrice principale répète “Et s’il n’est pas content, qu’est-ce que je vais faire ?”
Lorsqu’elle évoque la place de mère dans la société, Agnès Varda dit qu’elle ne nous permet pas facilement de faire tout à la fois
Elle n’essaie pas de le faire entendre. Elle l’affirme. L’engagement féministe d’Agnès Varda, il a toujours été là, il a juste été plus ou moins étiqueté comme tel. Dans les années 70 elle signe Le manifeste des 343, une pétition publiée dans Le Nouvel Observateur, qui sollicite la légalisation de l’avortement en France.
Il y a une des interventions d’Agnès Varda, qui m’avait beaucoup marquée
C’est une prise de parole sur un plateau télé dans laquelle elle dit : “Je crois qu’il faut redonner aux hommes la place qu’ils ont dans la vie des femmes, c’est à dire pas la première place. Ça c’est un petit peu dur à avaler, je crois. On peut peut-être le dire gentiment, mais la vie des femmes est faite de beaucoup d’autres choses que l’amour des hommes.”
En 1985, son film : Sans toit ni loi avec Sandrine Bonnaire remporte le Lion d’or à Venise
Le film raconte l’errance d’une jeune fille retrouvée morte de froid. La construction du film fait qu’on ne saura pas tout, ni de ce qu’elle était ni de ce qui l’a amenée là. Le film a fait beaucoup de bruit à l’époque. Ça c’est ma maman qui me l’a dit. Parce qu’il y avait quand même quelque chose d’un monde rural et marginal dont on ne parlait pas. Enfin qu’on ne montrait pas à l’écran. Et je me suis dit, bah, comme Courbet un peu, non ? J’exagère ? Bah disons que Courbet, Gustave, de son petit prénom, c’est un peu le chef de file du naturalisme rural au 19ème siècle.
Avant lui, les grandes toiles c’était pour des grands sujets, du noble, de la paillette quoi, des vénus, des grandes robes, des batailles historiques et des mecs musclés tous nus. Et Courbet, enfin Gustave, il dit, ah non. Ça m’intéresse bof, on va faire des très grands tableaux de la vraie vie, et aussi de la vraie vie à la campagne. Ce qui n’’était pas franchement ok au début. Quelque part, moi, je trouve que l’œuvre d’Agnès Varda, tout du long, c’est un peu ça aussi, remettre au centre, des gens qu’on met tout le temps sur les côtés.
Je crois que c’est l’une des chroniques dans laquelle j’ai le plus utilisé “Elle dit” et dans laquelle j’ai sans doute le plus cité la personne dont je parle
Il y aurait encore tant à dire à son sujet ou à laisser dire d’ailleurs. Je pourrais parler de son amour des chats, de sa relation avec Jacques Demy à la fin de sa vie, puisqu’ils se sont retrouvés et qu’elle a réalisé un film sur sa vie à lui. Je pourrais parler du film Les glaneurs et la glaneuse, qu’elle a fait produire en disant “La pomme de terre et moi on a envie de faire un film”, de son arrivée dans le milieu de l’art contemporain avec justement des patates en forme de cœur, de son engagement social, de ce qu’elle défend, c’est à dire un cinéma de qualité qui ne soit pas réservé à une élite, du personnage qu’elle est devenue avec sa coupe au bol bicolore, du documentaire qu’elle a réalisé avec JR en prenant la route avec lui à 88 ans.
Mais même en abordant tout ça, on serait encore un peu à côté. Ce que je peux vous dire, moi, c’est que j’ai adoré avoir la sensation d’apprendre à la connaître, pas seulement au travers de l’expo mais au travers de tout ce que j’ai vu ensuite grâce à la curiosité qu’elle a suscité chez moi. L’un des derniers textes de l’exposition explique que le cinéma d’Agnès Varda, c’est comme une pochette surprise, et c’est ce que j’ai découvert en rentrant chez moi ensuite et en me plongeant dans son univers.
Agnès Varda, c’est quelqu’un de libre, de libre dans la forme de ses films et dans sa manière de les faire quitte à ce que ça lui coûte
C’est quelqu’un de libre dans la forme de ses amours, dans son discours, dans sa façon d’approcher les gens et de dire les choses. C’est quelqu’un de libre, oui, mais qui n’enferme pas les autres dans le regard qu’elle porte sur eux. J’ai admiré sa force, sa façon de s’exprimer, sa façon d’être, toute la poésie teintée d’humour qui se dégage de ses œuvres, qu’elles soient photographiques, plastiques ou cinématographiques. Plus j’ai déambulé, plus j’ai été émerveillée par sa modernité, son engagement, sa liberté de ton et son humilité. J’ai aimé être tout autant bouleversée par ses mots que par ses films. Et puis, ce n’est pas quelqu’un que l’on a figé dans un temps particulier, au sommet de sa gloire et ou de sa jeunesse et pour finir ce que je retiens aussi de ce qu’elle a pu dire, c’est qu’il n’y a qu’un seul âge : vivante.
Au fond cette expo a été bien plus efficace que mon Caramel Macchiato
En sortant de la Cinémathèque, j’ai découvert avec bonheur que la plupart de ses films étaient disponibles sur Netflix et Arte. J’ai vu le même jour Les plages d’Agnès, qu’elle a réalisé, et Viva Varda ! de Pierre-Henri Gibert. C’est amusant comme la même histoire peut être vue et racontée de mille façons. Je suis sortie de là, avec une envie folle de chiper un pull rose fluo avec écrit Viva Varda ! en grand dessus comme tout le staff de la cinémathèque. Juste comme une manière simple de crier sur tous les trottoirs que son travail est formidable.
Mais je m’étale, je vous conseille de vous y rendre immédiatement si vous avez besoin de lumière
L’expo coûte 12€, c’est légèrement plus cher qu’un Caramel Macchiato mais ça fait du bien plus longtemps. Ça ouvre des portes qu’un café qui porte ton prénom n’ouvrira jamais. Vous y découvrirez un grand nombre d’extraits de ses films et des archives qui n’avaient jusqu’alors jamais été exposées. Les textes qui accompagnent l’exposition sont très bien écrits et hyper accessibles. Il y a peu d’expos où on peut lire l’intégralité des textes, ou disons plutôt, il y a peu d’expos où on a envie de lire l’intégralité de ces textes, Viva Varda! fait partie de ces expos là. Alors un grand bravo, à la commissaire de l’exposition Florence Tissot.
Et si vous ne pouvez pas voir l’expo d’ici le 28 janvier
Je vous conseille vivement de regarder Les plages d’Agnès sur Netflix, juste pour commencer. Il vous donnera, je n’en doute pas, très envie de voir tous les autres.
Bisette,
PS : On arrive bientôt à la fin de cette première saison de C’est comme la confiture
Si ça vous a plu, et que vous aimeriez que ça continue, n’hésitez pas à mettre des petites étoiles sur vos applications de podcasts et à en parler autour de vous ! Enfin, lâchez vos comms comme on disait en 2004.