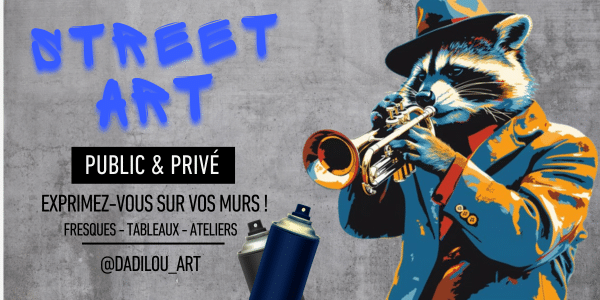Nombreuses sont les femmes artistes ayant marqué l’histoire de l’art. Par leur talent, bien sûr, mais aussi par leur attitude. Suite de la première partie consacrée aux pionnières, place aux agitatrices !
Berthe Morisot, sous les jupons de l’impressionnisme
Issue d’une famille aisée, Berthe Morisot (1841-1895) a la chance de pouvoir bénéficier avec sa sœur Edma d’une éducation artistique de qualité. Devenue par la suite belle-sœur et élève d’Édouard Manet, elle trouve un intérêt auprès des artistes impressionnistes dont elle rejoint le groupe. Contrairement à sa sœur qui a renoncé à faire carrière dans l’art pour embrasser le rôle traditionnel d’épouse et mère, Berthe Morisot travaille d’arrache-pied pour se faire accepter au sein du groupe. Mais aussi sur le marché de l’art, où elle essuie souvent des critiques misogynes.
Sa touche particulière et son travail sur la lumière d’une grande modernité la distingue de ses confrères. Ses figures semblent se dissoudre dans la douceur blanche qui émane de ses toiles. Mais cette différence passe aussi par le genre qu’elle privilégie : des scènes d’intérieur féminin. Dès cette époque, les critiquent et historiens la dépeignent d’ailleurs comme une peintre de la féminité. De là à en faire une icône féministe ? Le raccourci serait trop simple et l’Histoire ne l’a d’ailleurs pas fait. Elle a préféré conserver d’elle une autre image… peut-être encore plus réductrice.
Elle est la première et la seule femme à exposer à la première exposition impressionniste en 1874 dans l’atelier du photographe Nadar.

Et pourtant, l’Histoire a moins retenu d’elle son rôle de peintre que celui de modèle d’Édouard Manet, avec qui elle a cependant entretenu une passionnante relation d’influence artistique mutuelle. Malgré sa riche production – pas moins de 423 tableaux et tant d’autres aquarelles, pastels et gravures ! – l’État n’a acheté qu’une seule œuvre de son vivant. Et sur son certificat de décès, il est tristement indiqué « sans profession ».
A voir : plusieurs de ses œuvres conservées au musée d’Orsay à Paris.
Mary Cassatt, artiste moderne aux multiples talents

Une femme artiste doit être capable de faire des sacrifices primaires.
Cette Américaine à Paris peut être considérée comme un pont artistique entre les États-Unis et la France. Issue d’une famille américaine d’origine française et ayant grandi dans un milieu francophile, Mary Cassatt (1844-1926) étudie l’art entre ses deux pays d’attache et copie les œuvres du Louvre. Avant de s’établir définitivement à Paris, elle élargit sa culture artistique en découvrant les grands musées européens.
Remarquée par Edgard Degas qu’elle admire. Puis initiée à une approche plus moderne. Elle est une des rares femmes peintres, avec Berthe Morisot, à participer à l’aventure impressionniste. Contribuant ainsi au rayonnement du mouvement. En effet, son lien avec le Nouveau Monde lui vaudra d’être une véritable passeuse pour la peinture impressionniste aux États-Unis. Permettant alors à l’art français de traverser l’Atlantique durablement et avec succès.
Mary Cassatt puise son art dans les artistes féminines qui l’ont précédée, rendant hommage à celles qui lui ont ouvert la voie. Ainsi, comme Élisabeth Vigée-Lebrun, elle s’inspire de la peinture classique et notamment des sujets religieux dans ses compositions. A l’instar de Berthe Morisot, elle s’attache à des sujets typiquement féminins. Mais avec une palette vibrante, une touche très franche et d’une grande maîtrise chromatique. Son thème de prédilection sera donc la maternité, paradoxe quand on sait qu’elle ne fut jamais ni épouse, ni mère. Elle illustre pourtant avec une douceur et une tendresse infinies le duo intimiste, au point d’avoir été souvent reléguée à ce seul rôle.
Mais là où elle se distingue entre toutes, c’est sur le champ de la curiosité artistique et de l’innovation technique.
Durant les trente dernières années de sa vie, elle s’adonne à la gravure et voue une passion sans borne aux estampes japonaises. Elle possède même sa propre presse sur laquelle elle s’exerce. Son œuvre gravé suscite l’admiration de ses amis artistes. Elle doit cependant y renoncer car elle perd peu à peu la vue, avant de s’éteindre la même année que Claude Monet. Récompensée de la Légion d’honneur en 1904. Qualifiée en 1909 de « gloire de la France » par Georges Clemenceau. Sa gloire fut pourtant bien mince comparée à celle de son illustre confrère impressionniste.
A voir : l’encyclopédie de ses œuvres sur Wikiart
Camille Claudel, l’art à la folie

Tout ce qui m’est arrivé est plus qu’un roman c’est une épopée, l’Iliade et l’Odyssée, et il faudrait un Homère pour la raconter. (…) Je suis dans un gouffre. Je vis dans un monde si curieux, si étrange. Du rêve que fut ma vie, ceci est le cauchemar.
Triste est le souvenir que cette artiste remarquable a laissé dans l’Histoire de l’Art. On garde en mémoire les dernières années de sa vie, passées en hôpital psychiatrique. Alors même que son œuvre égale et pour certains dépasse même celui de son mentor Rodin. Notamment dans l’audace dont elle a su faire preuve pour son époque.
Née dans une famille bourgeoise, Camille Claudel (1864-1943) développe très tôt une affinité pour l’art, en particulier la sculpture. Son tempérament fougueux et déterminé la pousse à poursuivre sa vocation en se formant à Paris. Elle bénéficie alors des conseils du sculpteur Alfred Boucher. Appelé en Italie, il passe alors le relais à Auguste Rodin. En 1882, c’est LA rencontre qui marquera un tournant dans sa vie de femme et d’artiste.
Pendant dix ans de collaboration intense et tourmentée, passion et déception se disputeront les deux amants. Tantôt fusionnels tant dans leur vie que dans leur travail, tantôt condamnés à ne jamais connaître le repos ni dans l’une, ni dans l’autre.
Après un début de carrière dans l’ombre de l’illustre sculpteur puis sa violente rupture amoureuse, Camille Claudel tente de s’émanciper.

Par son art bien sûr afin de gravir les échelons de la gloire seule. En quête de sa propre identité créatrice, elle oriente ses recherches vers des scènes intimistes inspirées de la peinture de genre. Comme ses touchantes Causeuses (1897). Elle s’essaie de manière innovante à des matières difficiles et très peu utilisées en Occident jusque-là, comme l’onyx. Ses compositions polychromiques audacieuses font de la sculptrice une performeuse née. Lorgnant sur le japonisme alors à la mode ainsi que sur l’Art Nouveau, elle réalise même une sculpture inspirée de la fameuse Grande Vague d’Hokusai.
Mais la chute suit de près l’ascension de l’artiste, alors atteinte de troubles psychiques, auxquels s’ajoutent des difficultés matérielles et financières. S’ensuit alors une lente mais inexorable dépression, accentuée par le souvenir amer laissé par Rodin. Son aura, toujours présente, la bascule vers l’irrémédiable après la mort de son père en 1913. S’ensuivront trente années d’exil, enfermée dans sa propre démence. Internée en asile sur demande de sa propre famille.
Abandonnée par celle-ci ainsi que par le milieu artistique qui l’avait pourtant célébrée, elle se laisse dépérir. Elle renonce même à sa passion qui la gardait en vie jusque-là, pour s’éteindre seule et oubliée de tous en 1943. A ce destin tragique s’ajoute l’oubli dans lequel elle plonge, un abîme dont elle n’émergera que bien des décennies plus tard, à la redécouverte de son œuvre immense.
A voir et à visiter : ses œuvres au musée Rodin à Paris ; le musée Camille et Paul Claudel à Nogent-sur-Seine
Georgia O’Keeffe, grande dame de la peinture américaine

J’ai décidé d’oublier tout ce qu’on m’avait appris et de peindre exactement ce que je ressentais
Figure majeure de l’art moderne, Georgia O’Keeffe (1887-1986) est la seule femme peintre de la première vague de l’abstractionnisme américain. Ses fameux gros plans de fleurs géantes sont sûrement ses œuvres les plus connues du grand public. Leur allure est si contemporaine, alors même qu’elles ont été réalisées il y a plus d’un siècle.
A l’époque, la critique s’en est emparée, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Perçues comme hautement érotiques, on a longtemps dit qu’elles auraient été des interprétations des sexes féminins et masculins. Pourtant, cette analogie ne correspondait pas du tout à la volonté de l’artiste. Elle refusa même, pendant un temps, de montrer ses toiles. Cette approche purement féminine de la peinture florale est encore un exemple d’une critique éloignée de la vraie démarche d’une artiste novatrice.
Georgia O’Keeffe s’est certes emparée d’un sujet « mineur » et féminin, mais en le réinventant d’une façon nouvelle.
Loin de l’académisme et proche de l’abstraction, avec un zoom quasi photographique. Elle a aussi mis un point d’honneur à ne pas vouloir être présentée comme « femme artiste » mais comme « artiste » tout court…
Née dans le Wisconsin, d’origine hongroise par sa mère et irlandaise par son père, Georgia sait dès ses 12 ans qu’elle veut devenir artiste. Elle étudie à l’Institut d’Art de Chicago et l’Art Students League de New York entre 1905 et 1908. Double peine pour elle : elle est une des rares étudiantes femmes et l’enseignement très académique la déçoit. Elle renonce même à peindre pendant quatre ans, jusqu’à sa rencontre avec le peintre Arthur Wesley Dow en 1912. Celui-ci l’aide à se libérer et trouvé sa propre expression.
Mais c’est surtout sa rencontre avec l’éminent photographe et galeriste Alfred Stieglitz qui marque le vrai tournant de sa carrière. Il voit le potentiel de Georgia et l’expose, la révélant au public. Une relation se noue peu à peu entre eux. D’abord professionnelle et d’influence artistique mutuelle, puis amoureuse, puisqu’elle devient sa muse et épouse en 1924.
Stieglitz est alors non seulement un artiste reconnu, mais il est aussi l’un des seuls hommes à estimer qu’une femme puisse avoir du talent.

Il va jusqu’à considérer que la femme peut réaliser un travail similaire à celui d’un homme, une pensée assez révolutionnaire pour l’époque. Leur relation nourrit leurs travaux respectifs. Georgia devient le modèle de Stieglitz. Parallèlement, elle se nourrit de son approche photographique dont elle applique les principes dans ses « portraits géants » de fleurs. Elle commence à avoir une reconnaissance, mais la sensualité commune à ses portraits réalisés par son mari et ses propres toiles alimentent la critique. Celle-ci décrit alors de plus en plus son travail comme éminemment érotique.
Dès 1925, elle prend alors un virage en choisissant pour sujets les gratte-ciels qu’elle peut admirer lorsqu’elle s’installe au 30e étage d’un immeuble new yorkais. Bousculant les habitudes, faisant de ses sujets une exclusivité masculine, elle apporte sa pâte novatrice dans les représentations urbaines.
1929, nouveau tournant : ayant découvert qu’il la trompe, elle rompt avec son mari.
Elle s’éloigne en voyageant régulièrement au Nouveau-Mexique qui lui insuffle de nouvelles inspirations. Elle finit par s’y installer définitivement en 1940. Ses paysages désertiques, ses couleurs, l’intensité de sa lumière, ses grands espaces l’amènent à revenir à son travail plus abstrait. Elle se met à peindre des crânes, des ossements d’animaux trouvés dans le désert… Des œuvres incontournables aujourd’hui mais très surprenantes pour l’époque, surtout par leur côté quasi abstrait.
Son succès va croissant et ses expositions se multiplient. Elle est la première femme à bénéficier d’une rétrospective au MoMa de New York au milieu des années 1940. Malgré une perte progressive de la vue, couverte de distinctions honorifiques, elle continue à peindre jusqu’à son décès à Santa Fe, à l’aube de ses 100 ans. Il faudra pourtant attendre 2016 pour qu’on la redécouvre à travers sa première rétrospective posthume en Europe.
A visiter et voir : le musée Georgia O’Keeffe à Santa Fe ; le documentaire Georgia O’Keeffe, une artiste au Far West, d’Evelyn Schels (2021).
FIN de la 2nde PARTIE de notre dossier sur les femmes artistes, la suite ici (la précédente ici)
Pour découvrir encore plus d’articles inspirants, téléchargez l’application Cultur’easy sur Applestore ou Playstore.
Par Azza Frossard ,